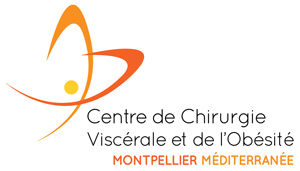- Accueil
- Chirurgie Bilio-Pancréatique
- Chirurgie pancréatique
- Pancréatite aigüe lithiasique
Pancréatite aigüe lithiasique
Utiliser notre service de téléconsultation
Estimer son poids idéal pour être en bonne santé
Jours et horaires de consultation
Clinique du Parc
50 rue Emile Combes
34170 CASTELNAU LE LEZ
Lundi 8h30/13h - 14h/17h
Mardi 8h30/13h - 14h/18h
Mercredi 8h30/13h - 14h/17h
Jeudi 8h30/13h - 14h/18h
Vendredi 9h/13h
Espace H2O
55 Avenue de Melgueil
34280 LA GRANDE-MOTTE
Clinique Via Domitia
235 Chem. des Alicantes,
34400 LUNEL
Qu’est-ce qu’une pancréatite aigüe lithiasique ?
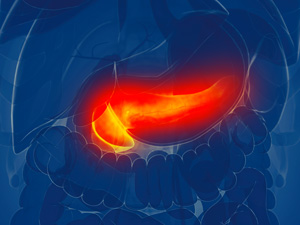 Une pancréatite est une inflammation du pancréas. Les deux causes les plus fréquentes sont l’alcool et les calculs biliaires.
Une pancréatite est une inflammation du pancréas. Les deux causes les plus fréquentes sont l’alcool et les calculs biliaires.
La pancréatite se traduit par une douleur épigastrique (au creux de l’estomac), irradiant classiquement dans le dos, soulagée par la position en chien de fusil.
Dans le cas de la pancréatite aigüe lithiasique, le pancréas est irrité par un calcul provenant de la vésicule biliaire ayant migré dans le canal cholédoque, allant du foie au tube digestif, dont la partie inférieure passe à travers le pancréas.
Le calcul qui irrite le pancréas peut passer spontanément dans le tube digestif ou resté coincé dans le cholédoque. La gravité de la pancréatite va alors être variable, évaluée par l’examen clinique et les examens complémentaires.
Quels sont les examens nécessaires ?
Un examen clinique est réalisé après un interrogatoire reprenant l’histoire des symptômes et les antécédents du patient. Il évalue les constantes : pouls, tension, température, saturation en oxygène. Le ventre est palpé à la recherche d’une défense abdominale voire d’une contracture. La fonction rénale est évaluée.
Les examens complémentaires :
- Un bilan biologique
C’est la prise de sang qui fait le diagnostic de la pancréatite en retrouvant un taux dellipase (excrétée par le pancréas) supérieur à 3 fois la normale. L’importance de l’inflammation est évaluée grâce notamment à la CRP. Une perturbation du bilan hépatique est aussi recherchée pouvant orienter déjà vers un blocage d’un calcul dans le cholédoque. - Une échographie abdominale
L’échographie abdominale recherche des calculs vésiculaires, une infection de la vésicule,u ne dilatation des voies biliaires orientant vers un blocage d’un calcul qui n’est souvent pas vu. Le pancréas est souvent difficilement visible car profond dans l’abdomen. - Un scanner abdominal
Le scanner doit être réalisé au mieux après 48 à 72H après le début de la pancréatite.
Il permet d’évaluer la gravité de la pancréatite en donnant un score, score de Balthazar, allant de la pancréatite non visible au scanner (pancréatite biologique) à la nécrose pancréatique. Il permet lui aussi de rechercher des calculs vésiculaires même s’il est moins perforant que l’échographie sur ce point, une infection de la vésicule, une dilatation des voies biliaires et un calcul cholédocien. - Une IRM biliaire
En cas de faible suspicion de calcul bloqué dans le cholédoque, une IRM des voies biliaires est demandée pour étudier le contenu des voies biliaires. - Une échoendocopie
En cas de forte suspicion de calcul des voies biliaires, une échographie des voies biliaires et du pancréas est réalisée par les voies naturelles, sous anesthésie générale. Si un calcule st retrouvé, il peut être retiré dans le même temps.
Quel est le traitement d’une pancréatite aigüe lithiasique ?
Le traitement d’une pancréatite est médical et repose sur le traitement de la douleur,l ’hydratation et la mise au repos du pancréas par le jeûne puis l’alimentation pauvre en graisse. La mise en place d’une sonde gastrique et/ou d’une sonde urinaire est parfois nécessaire.
Une hospitalisation aux soins intensifs voire en réanimation est parfois indispensable en fonction de la gravité de la pancréatite et de la présence de complications éventuelles. Ces complications peuvent être une infection de la nécrose pancréatique, un saignement, une perforation d’organe, une hyperpression abdominale, une insuffisance rénale aigüe pouvant nécessiter une dialyse. Un traitement spécifique de ces complications est alors mis en œuvre.
En cas de calcul bloqué dans le cholédoque, d’autant plus s’il est responsable d’une pancréatite grave ou d’une infection des voies biliaires par stagnation de la bile en amont appelée angiocholite, ce calcul est retiré par les voies naturelles par le médecin gastro-entérologue à l’aide d’un guide et d’un ballonné. On parle de cathétérisme rétrograde des voies biliaires. Ce geste est réalisé au bloc opératoire sous anesthésie générale. Les risques principaux en sont la pancréatite pouvant aggraver la pancréatite existante et l’hémorragie.
Une infection de la vésicule appelée cholécystite peut être associée. Il faut alors réaliser une ablation de la vésicule, le plus souvent par coelioscopie (caméra et petits orifices), dont le délai de réalisation dépend de la gravité de la cholécystite et de sa réponse au traitement antibiotique mais aussi de la gravité de la pancréatite.
Le traitement de la cause : le retrait de la vésicule
La pancréatite lithiasique est la conséquence d’une migration d’un calcul provenant de la vésicule. Pour traiter la cause il faut donc retirer la vésicule !
> En savoir plus sur le retrait de la vésicule
Cette ablation de la vésicule appelé cholécystectomie est réalisée par coelioscopie (caméra et petits orifices), sous anesthésie générale, après s’être assuré qu’il n’y a plus de calcul(s) dans le cholédoque ou après leur retrait. Dans certain cas il est possible de réaliser durant la même intervention le retrait du calcul du cholédoque par les voies naturelles et l’ablation de la vésicule par coelioscopie, le gastro-entérologue et le chirurgien travaillant alors conjointement.
En cas de pancréatite non grave, dès que cela est possible, la cholécystectomie est réalisée avant la sortie du patient. Sinon elle est réalisée peu de temps après, le plus souvent lors d’une ré-hospitalisation d’une seule journée en ambulatoire.
En cas de pancréatite grave, la cholécystectomie est réalisée en fonction de l’évolution de la pancréatite, le plus souvent à distance.
Les risques de la cholécystectomie
- Risques non spécifiques : hématomes (bénin), saignement, abcès, conversion en laparotomie (ouverture du ventre), troubles fonctionnels digestifs à type de diarrhée ou de constipation généralement transitoires.
- Risques spécifiques (très rares) : fuite biliaire, plaie des voies biliaires ; pouvant nécessiter une reprise chirurgicale et/ou des gestes endoscopiques.
- A distance : comme dans toute intervention abdominale, des déformations de la paroi de l’abdomen (éventrations) et des brides intra-abdominales sont possibles.
Régles hygièno-diététiques après une pancréatite
Règles à suivre pendant au moins 1 mois, jusqu’à la visite de contrôle avec le Dr Antoine GUILLAUD.
Conseils généraux
- Prenez le temps de manger, le repas devant durer entre 30 et 45 minutes
- Ne pas faire de repas copieux
- Installation assise pour la prise alimentaire
- Manger à heures régulières et prendre soin de bien mastiquer les aliments
- Fractionner les prises alimentaires et faire plutôt 5 à 6 repas légers que 3 repas abondants
- Privilégier les viandes blanches (poulet, dinde…)
- Privilégier les boissons en dehors des repas
- Buvez tout au long de la journée de 1 à 1,5 L/jour afin d’éliminer les résidus. Buvez de préférence entre les repas pour ne pas gonfler l’estomac lors des repas
- Éviter les boissons gazeuses, le café, les graisses et l’alcool, la vinaigrette, les fruits acides
- Éviter le tabac
- Éviter de porter des corsets ou des ceintures trop serrées
- Vous devez reprendre vos activités progressivement en privilégiant la marche
- Ne pas porter de charges lourdes et ne pas faire d’efforts intenses sur le ventre pendant 1 mois
La réalimentation
- L ’alimentation doit être pauvre en graisse au moins1 mois.
- Supprimer :
- Les aliments gras, riches en graisse cuite
- L’alcool
- Les plats cuisinés du commerce
Les aliments et les modes de cuisson
- Utiliser de préférence des matières grasses crues et cuisiner simplement :
- Viandes grillées, rôties, au four, bouillies. Pas de sauce, pas d’alcool.
- Poissons grillés, au four, en papillote, à la vapeur, en brochette. Pas de sauce, pas d’alcool.
- Œufs pochés, à la coque, durs, en omelette sur poêle anti-adhésive. Pas de sauce.
- Légumes en vapeur, micro-onde, cuisson à l’anglaise. Pas de sauce.
- Favoriser les cuissons qui conservent l’arôme comme les papillotes, au four, vapeur, grillades.
- Limiter les cuissons à l’eau qui ont tendance à diminuer les saveurs ou alors faire un court bouillon très parfumé.
- Eviter les cuissons grasses.
- Pensez aux aromates : noix de muscade, cannelle, poivre, curry, clou de girofle, paprika, romarin, fenouil, cerfeuil, persil, laurier, ciboulette, basilic, estragon, thym, sauge, ail, échalote, oignon, carotte, citron…
- Possibilité d’utiliser des sauces tomates ou encore sauce blanche.
- Vous pouvez aussi penser aux préparations sucrés / salées.
- Jouez avec les couleurs et les saveurs et pensez à réaliser une belle présentation, cela vous mettra en appétit.
Choix des aliments
| ALIMENTS CONSEILLÉS | ALIMENTS DÉCONSEILLÉS | |
| LAITS ET PRODUITS LAITIERS | Lait écrémé, ½ écrémé (selon tolérance) Yaourts, petits suisses, fromage blanc nature,aromatisés, aux fruits ou sucrés Fromages secs < à 20% de matières grasses Fromages allégés en MG 30 g/jour de fromage |
Lait entier, lait concentré sucré ou nature Laitages au lait entier, enrichis en crème… Fromage sec riche en matière grasse (c’est à dire supérieur à 20% de MG) Fromage frais à plus de 20% de MG |
| VIANDES POISSONS OEUFS |
Viande maigre comme le boeuf (faux filet, rumstecck, paleron, steak à 5% de MG…), le veau (filet, noix, escalope, longe…) Les volailles sans la peau Le porc : côte, rôti dégraissé, filet mignon L’agneau : gigot dégraissé Les gibiers, lapin Les abats : foie, rognon, cœur Les abats : foie, cervelle, langue, sans sauce Le jambon blanc ou cru, dégraissé, bacon, blanc de volaille (dinde ou poulet) Tous les poissons maigres sont autorisés minimum 2 fois/semaine Thon au naturel, miette de crabe au naturel Tous les coquillages, mollusques et crustacés Tous les œufs cuits sans matière grasse : de préférence le blanc (jaune selon tolérance) |
Viande grasse et morceaux gras des viandes : L’agneau (merguez, côte, épaule, collier) L’oie, le canard Le boeuf (côte, entrecôte, poitrine…) Le veau (côte, épaule, poitrine, collier…) Le porc (échine, poitrine, lard, côtes, saucisse Les charcuteries, confits, pâtés, saucissons, rillettes, salami, cervelas… La peau de la volaille Les abats : cervelle, langue, boudin, tripes Les plats en sauce Les poissons en conserve à l’huile, panés, fritures Tarama, accra, œuf et beurre de poissons Les plats cuisinés du commerce Les plats à base de préparation pâtissière comme la quiche, la pizza, les friands Les produits panés ou préfrits Les œufs frits, en mayonnaise, avec de la MG… |
| FÉCULENTS | Pain, biscottes Pâtes, riz, semoule Blé, polenta, quinoa, boulgour Pommes de terre vapeur, en purée, en robe des champs, en flocons Céréales du petit-déjeuner non chocolatées Légumes secs : lentilles, flageolets, pois chiches Farine |
Les produits frits ou pré-frits : frites, chips, féculents frits, sautés, pommes noisettes, dauphines, gratin dauphinois, en ragoût… Le pain de mie Les pains aux noix, lardons, olives Les plats préparés du commerce : raviolis, lasagnes, friands, cassoulet, choucroute… Les quenelles, quiches… Les biscuits secs salés (apérétif) et sucrés Les patisseries et viennoiseries maison ou industrielles Les pâtes feuilletées, brisées, sablées |
| LÉGUMES | Tous les légumes cuits ou crus frais, en conserve, surgelés, au naturel | Les plats de légumes cuisinés du commerce |
| FRUITS | Tous les fruits frais crus ou cuits surgelés au naturel sans sucre ajouté, frais soit 2 à 3 par jour | Les fruits secs, oléagineux (noix, noisette, olives, cacahuètes, pistaches, noix de coco…) Avocat |
| PRODUITS SUCRÉS | Sucre Confiture, miel, gelées de fruits Bonbons sans alcool Biscuits secs et desserts peu gras : Petit-beurre, biscuit à la cuillère, boudoirs… Biscuit de Savoie, génoise, gâteau au yaourt Flan au lait écrémé ou 1/2 écrémé Sorbets sans alcool |
La crème au beurre Les desserts sucrés, glaces Les glaces ou sorbet à l’alcool La chocolat, les pâtes à tartiner Les confiseries diverses Les pâtisseries à la crème, la chantilly Les viennoiseries, biscuits, beignets… |
| MATiÈRES GRASSES ET ASSAISONNEMENTS |
Epices Pour l’assaisonnement des salades : Huile de colza, de noix, d’ollive, de soja, de pépins de raisins, huile composée d’un mélange de plusieurs huiles (Isio 4, 4 huiles, Equilibre…) Pour la cuisson des viandes/poissons : Huile de tournesol, d’olive, de maïs, huile composée d’un mélange de plusieurs huiles Pour l’assaisonnement des légumes : Concentré de tomates – coulis de tomates |
Beurre cuit, beurre noir Margarines mixtes Sauces industrielles : Ketchup, mayonnaise, béarnaise… Bouillons de viande et de volaille non dégraissés Crème fraiche, entière, chantilly Saindoux, lard Graisse d’oie, de canard Végétaline Graisses animales Fritures Sauces avec de l’alcool |
| BOISSONS | L’eau est la seule boisson indispensable Eau du robinet, de source, plate ou gazeuse Thé, café, infusion, la ricoré Boissons aromatisées Jus de fruits 100% pur jus sans sucre |
Toutes les boissons alcoolisées Apéritifs, digestifs, cidre, bière… Vin Boissons au lait entier |
Exemple de matières grasses pouvant être consommées :
- AU PETIT DÉJEUNER :
10g de beurre cru allégé à 41% de M.G.
ou 10g de margarine 100% végétale à 40% de M.G. - AU DÉJEUNER ET AU DÎNER :
Vinaigrette : 1cuillère à café maximum d’huile par portion
Si vinaigrette du commerce : 1cuillère à soupe par portion
10g = 1 noix = 1 cuillère à soupe rase
5g = 1 noisette = 1 cuillère à café rase
UTILISEZ LE MOINS DE MATIÈRE GRASSE POSSIBLE !